| front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |review |
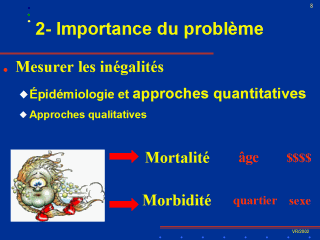 |
Il faut bien le reconnaître,
les recherches sur les inégalités sociales de santé sont dominées par les disciplines
ayant recours quasi-exclusivement aux techniques quantitatives. Ce sont principalement les
épidémiologistes qui ont tenu le haut du pavé ces dernières années. Il y aurait actuellement deux grandes familles de mesures, celles qui permettent de quantifier des différences entre des groupes (entre deux ou plus de deux) et celles qui concernent les différences entre les individus (Evans, Whitehead et al. 2001). Leclerc et Chastang (2000) proposent, quant à eux, de prendre en considération la mesure, d’une part, de la situation sociale, et d’autre part, des relations entre la position sociale et la santé. Ce type d’approche quantitative peut être dans certains cas très pertinent, mais dans d’autres - comme par exemple lorsqu’il s’agit de comprendre la complexité de la genèse et du vécu des inégalités de santé (Hamelin, Beaudry et al. 2002) - faire appel à une approche qualitative paraît mieux répondre aux besoins. Autrement dit, qualifier les inégalités (Fassin 2000) constitue une démarche complémentaire et quelques fois indispensable dans le champ des recherches sur les inégalités de santé. |