| front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |review |
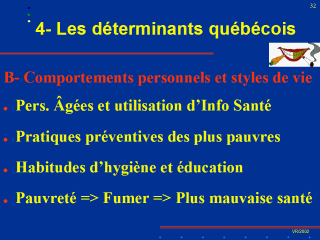 |
Le fait d’être une
personne âgée et donc de disposer d’un certain bagage de connaissances et de
pratiques serait un facteur réduisant le désir d’obtenir des renseignements,
selon les théoriciens de l’information. Cela a été constaté au Québec lors
de l’évaluation de l’utilisation du service Info-Santé CLSC puisque l’on a
découvert que l’âge et son corollaire comportemental concernant la recherche
d’informations était un facteur négativement associé à la connaissance de ce
service. Or, nous savons que ce service téléphonique permet, non seulement
de trier les patients et de réduire l’utilisation des services d’urgence
hospitaliers, mais aussi de répondre aux besoins de santé de la population,
besoins plus importants pour les personnes âgées que pour les autres. Par l’intermédiaire de la compilation d’études des années 70-80, Ginette Paquet montre que les femmes vivant dans les quartiers pauvres de Montréal ont des pratiques préventives bien moins présentes que celles habitants dans les quartiers riches. Le gradient demeure le même que l’on considère les taux d’utilisation de la ceinture de sécurité, de l’action de fumer ou l’inactivité physique pendant les loisirs Source : Paquet, G., Santé et inégalités sociales : un problème de distance culturelle. 1989, Québec: Institut québécois de recherche sur la culture. 131 --. |