| front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31|32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 | 41 |42 |review |
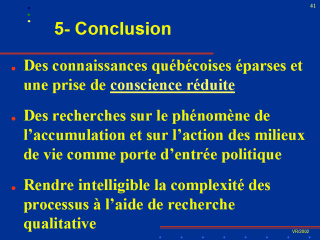 |
Les disparités
devant la mort et la maladie sont l’aboutissement d’un mécanisme cumulatif
d’injustices sociales dont les « faiseurs » de politiques publiques se
complaisent tant et autant qu’ils n’auront pas décidé de remettre en cause
cet état de fait. Pour reprendre les étapes du continuum d’actions
(diapositive suivante) liées à la réduction des inégalités sociales de
santé, nous pourrions aisément avancer que le Canada et le Québec font
partie des pays du peloton de queue. Le problème est mesuré, plus ou moins
reconnu et certains ont attiré l’attention de la population sur cette
question, mais la réponse se situe globalement dans une sphère de
l’indifférence ou du déni. Á la lumière des écrits étudiés, il nous semble qu’une attention particulière devrait être portée à la question du cumul des inégalités sociales tout au long du parcours de vie, ayant comme conséquences des résultats de santé différenciés. Tout se passe comme si le fait d’être dans une situation sociale défavorable ne faisait que renforcer l’apparition ou la présence de facteurs néfastes pour la santé des individus. L’inverse étant aussi vrai. L’étude approfondie des informations scientifiques québécoises ou internationales eu égard à la question des inégalités sociales de santé révèle que les connaissances en construction sont essentiellement d’ordres quantitatif et épidémiologique. Ce point de passage était obligatoire tant il demeure encore essentiel d’user de chiffres pour convaincre les décideurs et la communauté scientifique que les inégalités de santé ne sont pas naturelles. Cependant, nous voudrions préciser qu’il est peut être temps, maintenant, d’entrer dans la complexité des interactions et d’avancer dans l’élucidation des processus sociaux et politiques aboutissant aux résultats de santé différents, aujourd’hui bien explicités. |